Dans le monde de la bande dessinée, rares sont les auteurs emblématiques, qui sont aujourd’hui aussi connus que leurs œuvres. Frank Miller en fait partie, par la grâce de ses productions des années 80 et 90. Après avoir fait ses armes sur des séries estampillées Marvel (Daredevil) et DC (Batman, évidemment, avec Year One et The Dark Knight Returns), il y publie aussi Rônin, puis passe chez Dark Horse, éditeur indépendant alors en train de se faire un nom (Star Wars, The Mask, Usagi Yojimbo, puis bientôt Hellboy, The Goon…), qui éditera dès lors ses oeuvres personnelles les plus marquantes (Sin City, 300). Si ces dernières années prouvent que son âge d’or est passé, et bien passé (à noter la polémique lancée par son médiocre Holy Terror, mini-série à l’esthétique Millerienne à souhait, mais au propos fascisant et raciste), il convient de revenir vers ses meilleurs travaux, et Sin City en est un, sans aucun doute.
Sin City, c’est tout d’abord un choc esthétique. Si son graphisme radical faisait déjà mouche sur The Dark Knight ou Daredevil, le passage au noir et blanc lui permet de s’affranchir de toutes les scories graphiques qui polluaient parfois ses planches. Ici, tout est essentiel, rien ne dépasse, rien n’est de trop. La mise en page est explosive et expressionniste, le noir écrase les planches de sa lourdeur, et les éclats de blanc ne font que souligner les cicatrices béantes des divers personnages. Sin City est une date dans l’histoire du comics, parce qu’il a redéfini ce que l’on pouvait publier, à la fois grâce à la maestria visuelle de Miller, mais aussi à l’ouverture du marché du comics aux « creator owned », ces séries dont les auteurs conservent leurs droit (Image Comics étant le vivier de ce mouvement), et à la liberté d’action totale qui fut laissée à son créateur.
 Mais si le graphisme fut une révélation pour ceux qui eurent les volumes en main à leur parution, Miller n’a pas pour autant oublié de
Mais si le graphisme fut une révélation pour ceux qui eurent les volumes en main à leur parution, Miller n’a pas pour autant oublié de  raconter une histoire. Et quelle histoire ! Si les personnages qui parsèment ses pages crépusculaires ne sont jamais des héros, ils incarnent les caractères monolithiques qui firent le succès des polars hard boiled américains des années 30 à 50. Torturés, cachant tant bien que mal la misère amoureuse qui leur fait prendre des décisions idiotes, ils sont lâchés sur une route qu’ils ne choisissent jamais réellement, mais qui les mènera systématiquement à leur perte. Les personnages principaux se croisent, au fil des volumes, passant à l’avant ou retournant à l’arrière plan. Et les personnages féminins sont, dans l’ensemble, soit des femmes fatales, manipulatrices et garces, soit des femmes fortes, vendant leur corps pour leur propre compte, et promptes à démolir quiconque se mettra en travers de leur chemin. N’oublions évidemment pas le vrai héros de cette série, la ville, Sin City, pourrie jusqu’à la moelle, peuplée d’une faune disparate et répugnante : politiciens véreux, fils à papa aux occupations ignobles, flics corrompus, et bien évidemment, le quartier sensément mal famé, qui contient clairement les personnages le s plus touchants et les plus humains de la cité, prostituées en tête.
raconter une histoire. Et quelle histoire ! Si les personnages qui parsèment ses pages crépusculaires ne sont jamais des héros, ils incarnent les caractères monolithiques qui firent le succès des polars hard boiled américains des années 30 à 50. Torturés, cachant tant bien que mal la misère amoureuse qui leur fait prendre des décisions idiotes, ils sont lâchés sur une route qu’ils ne choisissent jamais réellement, mais qui les mènera systématiquement à leur perte. Les personnages principaux se croisent, au fil des volumes, passant à l’avant ou retournant à l’arrière plan. Et les personnages féminins sont, dans l’ensemble, soit des femmes fatales, manipulatrices et garces, soit des femmes fortes, vendant leur corps pour leur propre compte, et promptes à démolir quiconque se mettra en travers de leur chemin. N’oublions évidemment pas le vrai héros de cette série, la ville, Sin City, pourrie jusqu’à la moelle, peuplée d’une faune disparate et répugnante : politiciens véreux, fils à papa aux occupations ignobles, flics corrompus, et bien évidemment, le quartier sensément mal famé, qui contient clairement les personnages le s plus touchants et les plus humains de la cité, prostituées en tête.
Le film, que Miller co-réalisa avec Roberto Rodriguez, et qui s’inspire des volumes 1, 3 et 4, reste une réussite graphique, malgré le risque d’un vieillissement rapide du aux effets spéciaux particulièrement outrés.
Mais rien, non, rien ne remplacera la lecture de ces polars tordus, brillants, intemporels, que sont les Sin City !!
Du même auteur :
Dans le même genre :




















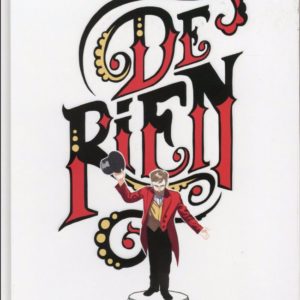





Laisser un commentaire