 Lenny Kravitz fait partie de ce genre d’artistes qui n’auraient pas existé sans les autres (Marvin Gaye, James Brown, Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, John Lennon, les Stones… la liste est longue). Rajoutez-y une grosse dose d’amour, une orientation catho surprenante, d’énormes talents d’arrangeur et une panacée de conquêtes toutes plus fondantes les unes que les autres: vous obtiendrez le sex-symbol black-blanc des années 90. Maîtrisant les codes de n’importe quel genre, Kravitz continue d’être inclassable. En même temps, qui classe quoi à l’heure des playlists squattées par les Black Eyed Peas et du téléchargement où se bousculent torchons et serviettes, peste et choléra, dans le fonds des poches d’une majorité ravie de noyer l’industrie et ignorant l’âge d’or du microsillon. Merci internet. Foncièrement vintage – et donc bien élevé, le problème avec Lenny est ailleurs. Plus ses albums s’empilent (on arrive au neuvième en un peu plus de vingt ans), la quantité ne sauvant pas forcément la qualité, plus on oublie facilement tout ce qu’il a fait, la mémoire restant bloquée sur l’héritage lourd de « Let love rule » (1989), « Are you gonna go my way » (1993) et « 5 » (1998), soit 25 millions d’albums vendus sur neuf ans. En fin de compte, c’est déjà pas mal. Sans mauvaise fois aucune, une chronique d’album de Lenny Kravitz se laisse avant tout guider par le respect et moins par la flamboyance quasi-absente de ses albums depuis dix ans.
Lenny Kravitz fait partie de ce genre d’artistes qui n’auraient pas existé sans les autres (Marvin Gaye, James Brown, Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, John Lennon, les Stones… la liste est longue). Rajoutez-y une grosse dose d’amour, une orientation catho surprenante, d’énormes talents d’arrangeur et une panacée de conquêtes toutes plus fondantes les unes que les autres: vous obtiendrez le sex-symbol black-blanc des années 90. Maîtrisant les codes de n’importe quel genre, Kravitz continue d’être inclassable. En même temps, qui classe quoi à l’heure des playlists squattées par les Black Eyed Peas et du téléchargement où se bousculent torchons et serviettes, peste et choléra, dans le fonds des poches d’une majorité ravie de noyer l’industrie et ignorant l’âge d’or du microsillon. Merci internet. Foncièrement vintage – et donc bien élevé, le problème avec Lenny est ailleurs. Plus ses albums s’empilent (on arrive au neuvième en un peu plus de vingt ans), la quantité ne sauvant pas forcément la qualité, plus on oublie facilement tout ce qu’il a fait, la mémoire restant bloquée sur l’héritage lourd de « Let love rule » (1989), « Are you gonna go my way » (1993) et « 5 » (1998), soit 25 millions d’albums vendus sur neuf ans. En fin de compte, c’est déjà pas mal. Sans mauvaise fois aucune, une chronique d’album de Lenny Kravitz se laisse avant tout guider par le respect et moins par la flamboyance quasi-absente de ses albums depuis dix ans.
Passer de Virgin à Roadrunner Records traçait à priori une destinée hardeuse au successeur de « It’s time for a love revolution » (2008) déjà bien plus rock que pop.Sauf que, comme d’habitude mais sans doute plus qu’à l’accoutumée, on retrouve beaucoup de soul et de groove dans « Black & White America ». Autre effet mesurable de l’élection d’Obama: un énième hommage mielleux de Lenny Kravitz à la black music. C’est bien évidemment Curtis Mayfield et Marvin Gaye que l’on reconnaît en premier lieu, dès les premiers couplets groovy et sensuels de la chanson titre « Black & White America », dans les intonations félines et expressives de « Looking back on love » et sur le beat erotico-synthétique de « Liquid Jesus ». On peut apercevoir du Stevie Wonder grossier sur « Sunflower » ou de l’imparfait James Brown sur « Life ain’t ever been better », heureusement sauvé par la paire tapante basse-batterie. « Than it is now » véritable pastiche de lui-même, envoute plus qu’elle ne dégoute, »Rock star city life » évite de justesse et grâce à la puissance de son riff la caricature d’un Bon Jovi des années 80, et « Come on get it » trouvera sûrement sa place sur une éventuelle future bande-son d’un Godzilla 2. Hormis les parties grooves, les réussites se situent dans le ventre mou de l’album, soit le funky « Superlove » et son solo à facettes, le très kravitzien « Everything » où voix et guitares s’envolent, et « I can’t be without you » qui nous laisse deviner ce qu’aurait été un Bowie non pas aux yeux vairons mais à la peau marron. Le choix de mélanger les genres? Un chemin de croix pour les puristes nostalgiques, un labyrinthe trop compliqué pour le commun des mortels. Même si le talent et une production impeccable sont là, de Lenny Kravitz on ne peut plus attendre ni surprise, ni renversement. Sincère, avançant dans un fidèle esprit de paix et d’amour, Lenny a fait du cliché noble son fonds de commerce. 47 ans cette année, sexy et en forme, on s’en contentera…


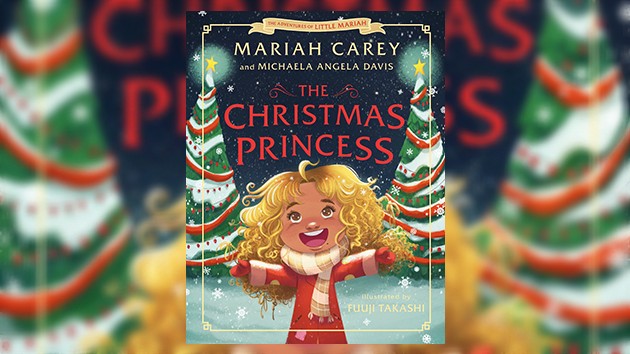
Laisser un commentaire