En proposant une musique vintage en marge du phénomène obsolète des « baby-rockeurs », les membres de Mustang ont eu la chance de surprendre au bon moment. Suffisants pour certains, assurément meilleur groupe français pour d’autres, les provinciaux avancent le menton relevé et le vent dans le dos. Refusant l’étiquette rétro que l’on veut bien leur coller, leur banane les trahi pourtant, du cuir chevelu au sourire, en passant par le milk-shake qu’on aurait volontiers partagé avec eux, en vain. Mais dieu merci, un statut de néo-parisien ne fait pas oublier d’où l’on vient. Clermontois un jour, clermontois toujours. Interview chauvin.
Bon les gars, quand on s’emmerde à Clermont-Ferrand, on fait du rock, c’est ça?
Rémi Faure (batteur): Entre autres choses… Mais c’est une façon de ne pas s’emmerder ouais.
Plus sérieusement, qu’est-ce qui vous a poussé à faire du Rock?
Jean Felzine (guitare, chant): Bin, parce qu’on en écoutait déjà…
Johan Gentile (basse): Le premier truc c’était d’essayer de choper un petit peu avec ça, se faire des nanas.
Rémi Faure: C’est vrai qu’au tout départ, on fantasmait là-dessus, la vie des rockstars, se défoncer et baiser à longueur de journée! (rires).
Comment tout ça a démarré? Rencontre au lycée, déclic immédiat?
J.G.: On était au lycée en seconde, et on s’est dit: « et si on apprenait à jouer d’un instrument? » Jean a pris la guitare, Rémi la batterie et moi la basse. On a tout appris ensemble, ça a mis un petit peu de temps, au fur et à mesure on a fini par progresser et aujourd’hui on se retrouve sur les routes.
Alors, premier album: « A71 ». L’autoroute A71, c’est pas direction Paris ça, si?
J. G.: Ah si, justement! En fait non, l’A71 c’est Orléans mais en bifurquant tu finis à Paname! (rires)
J. F.: »A71″, c’était plus le choix d’un titre sous forme de sigle, un truc qui permet aux gens de nous poser des questions.
Justement, se délocaliser à Paris, c’était nécessaire. Un groupe qui reste cloîtré en province pendant des années finit souvent par jouer dans les foires à la saucisse du coin…
J. F.: C’est sur qu’on ne voulait pas ça. Et vu que l’on n’avait pas un succès phénoménal là-bas, qu’on n’était pas le groupe star de la ville, bouger à Paris était primordial, il fallait qu’on se casse.
Quand vous dites « star de la ville », c’est par rapport aux groupes issus du label Kütü Folk plutôt bien côtés sur la scène Rock?
J. G.: Je ne pense pas qu’on puisse parler de « stars ». C’est clair qu’ils ont une certaine notoriété là-bas mais quand on a commencé, il y avait surtout les Elderberries qui cartonnaient pas mal. Et puis quand on a signé avec le label parisien Arag Records en 2008, on commençait à monter souvent en studio dans la capitale; donc pour se faciliter la vie, on a migré. C’est d’abord Jean qui est parti, et puis on l’a suivi. C’était plus simple pour les rencards, pour les répèt’…
A une époque, il y avait des bons papiers sur Clermont-Ferrand dans la presse spécialisée, une ville présentée comme nouvelle capitale du rock en France. Vous avez profité de ça?
R. F.: Ouais il y avait même un article sur le dernier disquaire indé de la ville (Spliff Ministore)! Alors oui, ça a fait parler…
Les gens évoquent souvent le style rétro de votre musique, mais ce qu’ils oublient souvent c’est la particularité des textes en français. Et à mon sens, il n’y a pas énormément de groupes qui mélangent le rock rétro avec la langue de Molière… Dès le départ, c’était clair dans votre tête?
J. F.: Oui, on ne s’est jamais posé la question. Mais on n’est clairement pas les seuls, il y a aussi les BB Brunes…
Oui, mais quand on parle rétro en Rock, on commence au début des 50’s et on s’arrête en 1964 avec l’arrivée des Beatles…
J. F.: Oui, c’est vrai, on est sûrement plus rétro car on va voir un peu plus loin, mais en même temps, on n’entend pas de synthés sur la musique des BB Brunes. Tu vois, je ne nous considère pas plus rétro qu’eux. Tout le monde va chercher dans le passé aujourd’hui.
Les gens qui jugent trop hâtivement Mustang par leur look « Happy Days », ça vous gêne?
J. F.: Ca nous a surtout permis d’avoir une certaine visibilité, et en vérité, ça nous a plus servi qu’autre chose.
J. G.: Mais c’est normal, lorsque nous sommes arrivés avec notre premier album, on ne s’est pas bien fait comprendre. Et avec le deuxième, on a vraiment essayé de poser notre identité, de rectifier le tir, et c’est pour ça qu’il y a moins de reverb et de guitares 50’s.
Pour construire les morceaux, vous dites être allés aux racines du rock, quand d’autres s’arrêtent un peu avant…
J. F.: Honnêtement, on y revient toujours. De la country, du blues ou du rock originels… C’est vrai que c’est une bonne partie de ce qu’on aime mais on a aussi écouté beaucoup de choses psychédéliques des 70’s. Les racines du rock sont une quête permanente pour nous, on cherche des disques, on écoute des tonnes de trucs…
J. G.: On écoute des disques que l’on considérait comme modernes à leur époque.
Et puis il y a le déclic Elvis: « My baby left me » devient: « Ma bébé me quitte »…
J. F.: Exactement! Elvis est le plus grand selon moi…
Vous citez également Big Star parmi vous influences. Un groupe qui n’a pas eu de bol…
J. G.: Oui, ça c’est encore différent concernant Big Star. Ils ont peu vendus, leur promo a été mal faite… Nous on essaie de capter l’essence du Rock, c’est pas le tout d’utiliser des guitares, il faut transmettre un truc avec.
Quand vous citez aussi Roy Orbison ou Elvis, ça change un peu des références habituelles, encore une fois c’est plus rétro…
J. F.: Je me souviens, la première fois où je suis tombé sur un best of de Roy Orbison, je suis tout de suite tombé amoureux, je l’écoutais en boucle. Alors là, pour le coup, on est plus dans une sorte de variété américaine que dans du Rock’n’roll.
Actuellement, on fête les quarante ans de « L.A. Woman » des Doors, les trente-cinq ans de « The Wall » des Pink Floyd. C’est très bien, mais au jeu des rééditions, ne trouvez-vous pas que les années rétro sont oubliées? Elles sont pourtant fondamentales dans la transmission du rock puisqu’elles en sont la base…
J. F.: Elvis a vendu assez de disques, mais il faut être prudent avec cet héritage. Il y a quelques années, ils ont sorti une horreur (« Viva Elvis ») en gardant la voix d’Elvis mais en changeant les arrangements.
R. F.: Il y avait un chanteur de chaque pays qui chantait par-dessus, des aberrations genre Amel Bent…
J. F.: Vu que les maisons de disques ne font plus assez de chiffre avec les jeunes groupes, c’est normal de puiser dans ces trucs-là. Peu importe, on peut être content que les rééditions des Doors ou autres trucs bien gold se vendent encore, ça leur permet d’avoir un peu de thune pour nous faire vivre nous. Mais avec tout le revival rock que l’on a eu depuis dix-douze ans, tous ces groupes ont puisé dans le rock vintage des 70’s et ne parlaient pas des 50’s. Alors nous aussi on a beaucoup écouté les Stooges, mais moins que Bo Diddley ou Elvis. Peut-être une manière de se démarquer, en fait…
Justement, vous disiez que les mecs qui partageaient votre lycée écoutaient des groupes comme les Ogres de Barback, la Rue Ketanou, des choses rapidement passés de mode…
J. F.: Beaucoup oui, pas tous, il ne faut pas exagérer (rires).
R. F.: On était dans un lycée de bobo-hippie aussi, il faut le dire…
J. F.: Ouais il y avait ça, mais également le néo-métal qui a duré longtemps, des groupes californiens, des gros vendeurs genre Muse, Radiohead… Mais aucun de ces trucs-là ne nous faisait bander, c’était pas notre truc…
Vous étiez déjà en marge, ce qui aide à devenir quelqu’un sur le plan musical, finalement…
J. F.: Tout à fait, mais après je pense que sur Paris, tous les mecs que l’on surnommait les baby-rockers écoutaient les Stooges et tout ça, ce qui était sans doute beaucoup plus facile pour eux, ils avaient des gens à même de leur faire écouter des disques dans leur entourage, ils pouvaient voir beaucoup de concerts au Gibus ou ailleurs…
Aujourd’hui, et à cause des concepts « Nouvelle Star », on a l’impression que les jeunes qui font de la musique le font de manière calculée, avec des plans chiffrés, des concepts pré-conçus… Où est l’esprit Rock là-dedans? Le fantasme dont on parlait tout à l’heure?
J. G.: C’est pas pareil. Pour la nouvelle star, en général, la plupart des candidats sont des interprètes qui, en caricaturant un peu, aiment juste chanter des chansons, donc tout sera calculé dans le sens où ils arrivent. C’est un autre boulot. Nous on est un groupe et on essaye de réfléchir à tout dans notre travail.
Et puis, dès le début, vous aviez les idées plutôt claires, non?
J. F.: Oui et non. On a des idées, mais elles ne sont pas toujours très claires. On n’a pas la science infuse. Il ne faut pas négliger l’importance de l’entourage. Les Stones avaient certainement un manager qui voyait de grandes choses pendant qu’eux souhaitaient faire du blues pur et dur… Pour ce qui est de ces artistes d’aujourd’hui qui calculent, ce que je regrette dans tout ça, c’est le terme « univers », utilisé à outrance par les maisons de disque. Selon eux, il faut absolument créer un univers autour de l’artiste. On va te choisir ces fringues là, même si tu n’as pas de chansons on va te faire ça ou ça… Le mot « univers » a tout envahi. Les gens te disent: « tiens, j’adore l’univers de Tom Waits ». Moi je m’en fous de son univers, c’est sa musique que j’aime. Si on prend James Brown, c’est quoi son univers? Il n’a pas d’univers, c’est un génie, c’est tout. Vendre un espèce de « package univers », c’est l’erreur à ne pas faire. Ben l’oncle Soul en est la dernière victime, c’est pas mal foutu mais il y a plus un travail marketing que musical. Vendre ça sous « Motown France », c’est de la rigolade…
Vous, on ne vous a pas trop mis de battons dans les roues en terme d’univers?
J. F.: (hésitant) Et bien…. Pour des séances photo, on nous a prêté des fringues, des accessoires, c’est normal… Mais j’ai tellement gueulé contre ce mot univers qu’il est devenu tabou pour mon producteur. Il n’a plus le droit de le prononcer en ma présence (rires). Le plan du: « on va raconter une histoire avec ça, on va te créer un univers… ». C’est gerbant.
Ce phénomène s’illustre à merveille sur un groupe qui cartonne ici: les Baseballs. Qui reprennent du Rihanna en rockabilly et à qui la banane ne va pas foncièrement bien…
R. F.: Ah ouais! Des allemands, c’est ça? On s’en fiche, franchement… (rires)
Vous avez participé au disque hommage à Alain Bashung. Pas trop dégoutés d’avoir été évincé à la dernière minute? Surtout lorsqu’on écoute les versions de M ou de Keren Ann qui sont totalement râtées…
J. F.: En fait, je crois que ça a fait parler d’elle plus qu’autre chose. Avec du recul, ça n’engage que moi hein, mais je m’en fous. Et puis il faut dire qu’au moment du tribute, on était en plein enregistrement de notre deuxième album, alors tout s’est chevauché, on avait plus la tête à notre propre disque.
Vous aviez déjà croisé Alain sur les routes, non?
J. F.: On avait fait une première partie d’un de ses concerts, oui.
J. G.: C’était le Bashung malade, oui, le Bashung de la fin. Un mec impressionnant, classe. On est très fier de lui avoir rendu hommage, c’est juste regrettable que l’on ne soit pas sur le disque.
R. F.: Le voir dans cet état, ça calme. Mais pour le peu qu’on l’a vu, le mec était classe, fidèle à sa réputation.
J. F.: Tous les gens qui l’ont rencontré le disent: la grande force de Bashung, c’était sa classe, naturelle comme artistique.
Toutes les influences que vous me citez (Orbison, Elvis…) sont américaines. Ca vous dirait, un jour, d’aller enregistrer là-bas? Goûter à l’atmosphère de villes comme Memphis ou Nashville, jouer avec des mecs du pays? Mais toujours en français, s’il vous plaît…
J. G.: Sauf si ça justifie vraiment le déplacement, si on peut avoir un son propre à la ville, à l’atmosphère, pourquoi pas. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. T’as des super studios ici en Europe…
J. F.: Franchement, ce n’est pas comme si on était de simples interprètes, on n’a pas forcément besoin de musiciens, on fait déjà tout nous-mêmes. Je peux comprendre qu’un mec veuille enregistrer avec des américains, pour avoir un certain style et tout ça, mais nous, que l’on soit en studio américain ou japonais, ça reste nous.
R. F.: Mais faire des dates là-bas, ce serait fort quand même…
Si vous deviez me citer un grand de la chanson française encore vivant, vous me diriez?
R. F.: Christophe…
J. F.: Dominique A, je trouve qu’il a des trucs balaises…
Tombés dans le piège! Le clermontois ne doit pas oublier Jean-Louis Murat…
J. F.: Alors oui, je ne connais pas beaucoup, mais les deux ou trois trucs que j’ai écouté de lui, c’est fort. Et puis il reste Johnny Hallyday quand même, Aznavour… Si si, il en reste des grands monsieur de la chanson.
Question rockeurs made in France, si il fallait choisir entre Johnny Hallyday, Eddy Mitchell ou Dick Rivers…
J. G.: Eddy Mitchell. En tout cas c’est celui que je préfèrerais rencontrer.
R. F.: C’est clair, en plus dans les trois c’est le personnage qui a l’air d’être le plus cool.
J. F.: Pas sur qu’il soit le plus cool. Mais Eddy, je pense que c’est l’exact miroir de Johnny. Même si, il faut le dire, il était moins beau gosse que lui, c’est le rockeur qui est allé le plus dans la dérision pendant qu’Hallyday est toujours resté dans le premier degré, et ça lui va très bien. Mais bon, ils sont quand même complémentaires.
Savez-vous qui est le numéro un pour Eddy?
J. F.: Lui-même non? Il a pas dit un truc comme ça?
Chuck Berry. On a parlé Rock sans parler de lui. Grave erreur…
J. G.: Il est vrai que Chuck Berry a fait pas mal de morceaux assez énormes. Pourquoi pas.
J. F.: Personnellement je trouve qu’il en a fait moins que Buddy Holly mais bon…
Propos recueillis par Gyslain Lancement
Albums « A71 » et « Tabou » disponibles en CD (Sony Music)



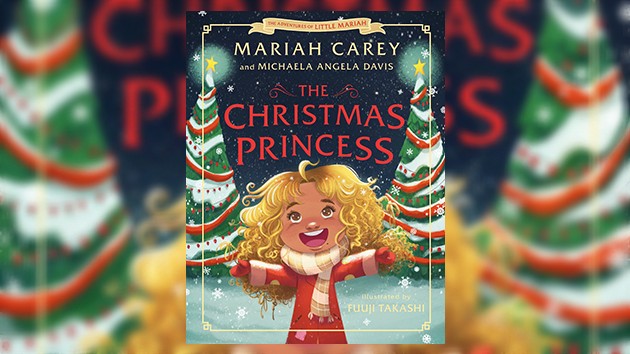
Laisser un commentaire