Il est de ces années ou l’on n’achète que quatre disques en douze mois. Si la décennie 80’s a eu son lot de bides monumentaux, pour 2012, c’est plus grave. Le disque touche à sa fin. De mon vivant, je ne l’imaginais pas, n’y pensais même pas. Aujourd’hui, comme bon nombre de presque trentenaires, je le vis et commence à regretter ce temps qui n’est pourtant pas si loin. Mon meilleur ennemi est internet, copain de trouvailles à moindre frais, mais véritable Viet-nam de l’industrie. Ne prenez pas peur, je ne suis pas là pour ça, déjà que ce fut assez dur de trouver une quinzaine de bons disques… Parce que le vrai evenement de cette année 2012, c’était plus la reformation des Stone Roses qu’un énième album ennuyeux de Bob Dylan; à quelques encablures de la fin du monde, sa « Tempest » est longue et chiante pour les immatures que nous sommes. Je suis dur avec lui? Non, il ne faut pas me raconter de salades, mais sa boisson pour bonhomme, ce disque pourtant 4 étoiles est, je me répète, long et chiant, et ne donne clairement pas envie de devenir le dernier vestige d’une planète toute prête à péter. Pourvu que « l’Highway 61 » lui survive…. Sorry, ayant grandi dans les 90’s, la première cassette à s’être débinée dans mon esprit était estampillée Madchester. A faire péter le monde, de Sziget à n’importe quel festival qui a pu se payer le luxe de montrer au monde qu’en fait ce n’est pas Liam Gallagher qui a le plus la classe tout tordu derrière un micro, le retour scénique de Ian Brown (photo ci-dessus) et ses acolytes a fait l’unanimité à peu près partout. Respect. Parenthèse bouclée, et puisqu’on ne fera que fantasmer sur un potentiel retour de l’ecstasic summer, il nous reste au moins les 11 minutes d’un « Breaking to heaven » pour s’envoyer en l’air avant la fin du monde.
En 2012, il y a eu des sorties en pagaille, mais pas d’âme. Ou si peu. Et je ne vais pas vous parler de mecs qui tricotent ou qui bricolent. Je vais vous parler franco, vous imposer ma dictature d’une musique que j’aime et que je ne vois pas vieillir. Je vous laisse donc le choix entre du Rock et du Rock. Avec quand même un soupçon de Soul. A vous de le trouver…
 The Cult, « Choice of weapon »: Le plus américain des groupes anglais a retrouvé sa fougue « Electric » (1987) que l’on croyait momifiée, refusant de s’enfermer dans le souvenir glam-métal d’il y a trente ans. Ian Astbury, plus hargneux que jamais, montre encore qu’il est un des plus grands chanteurs de Rock de l’histoire. Même si il commence timidement au niveau vocal, l’album est bien meilleur, au sens péchu, que leur résurrection de 2007 qui sonnait plus comme un au revoir par la petite porte. Accompagné de son fidèle guitariste Billy Duffy – injustement absent de la plupart des classements de maîtres de la six cordes, allez au diable! – Astbury donne une leçon de chant. « Choice of weapon » est un album pour tout ceux qui, après ces dix titres virulents, sauront placer Ian Astbury – j’insiste sur ce point - en haut de la hiérarchie succincte des tous grands chanteurs de Rock actuels, et qui pourraient même se demander à quoi auraient ressemblé les Doors s’ils avaient virés heavy.
The Cult, « Choice of weapon »: Le plus américain des groupes anglais a retrouvé sa fougue « Electric » (1987) que l’on croyait momifiée, refusant de s’enfermer dans le souvenir glam-métal d’il y a trente ans. Ian Astbury, plus hargneux que jamais, montre encore qu’il est un des plus grands chanteurs de Rock de l’histoire. Même si il commence timidement au niveau vocal, l’album est bien meilleur, au sens péchu, que leur résurrection de 2007 qui sonnait plus comme un au revoir par la petite porte. Accompagné de son fidèle guitariste Billy Duffy – injustement absent de la plupart des classements de maîtres de la six cordes, allez au diable! – Astbury donne une leçon de chant. « Choice of weapon » est un album pour tout ceux qui, après ces dix titres virulents, sauront placer Ian Astbury – j’insiste sur ce point - en haut de la hiérarchie succincte des tous grands chanteurs de Rock actuels, et qui pourraient même se demander à quoi auraient ressemblé les Doors s’ils avaient virés heavy.
 Public Image Limited, « This is PIL »: Personne ne s’y attendait vraiment. A trop vouloir parler des Sex Pistols, on en oublie presque l’importance considérable de la période post-punk de son taré d’ex-leader, John Lydon. Au sein de PIL, Lydon nous a tout fait. Lydon, c’est quand même le mec qui ose un album d’une fraîcheur considérable vingt ans après le dernier, et débutant de manière effrontée ce nouveau-né musical par un rot monumental sans que l’on ait envie de l’envoyer se faire foutre. So Punk! « I am John, and i was born in London, I am no vulture, this is my culture. » A tous ceux qui le voient tenter un come-back le ventre vide: vous ne pouvez pas lui faire plus plaisir. Sur « This is PIL », Lydon s’amuse. Prendre ce que l’existence veut bien nous donner d’encore fun, brailler des vers sur une basse ronflante et des rythmiques biliaires et ne plus parler des Sex Pistols, c’est compris?
Public Image Limited, « This is PIL »: Personne ne s’y attendait vraiment. A trop vouloir parler des Sex Pistols, on en oublie presque l’importance considérable de la période post-punk de son taré d’ex-leader, John Lydon. Au sein de PIL, Lydon nous a tout fait. Lydon, c’est quand même le mec qui ose un album d’une fraîcheur considérable vingt ans après le dernier, et débutant de manière effrontée ce nouveau-né musical par un rot monumental sans que l’on ait envie de l’envoyer se faire foutre. So Punk! « I am John, and i was born in London, I am no vulture, this is my culture. » A tous ceux qui le voient tenter un come-back le ventre vide: vous ne pouvez pas lui faire plus plaisir. Sur « This is PIL », Lydon s’amuse. Prendre ce que l’existence veut bien nous donner d’encore fun, brailler des vers sur une basse ronflante et des rythmiques biliaires et ne plus parler des Sex Pistols, c’est compris?
 Led Zeppelin, « Celebration day »: Un live de 2007 en multi-formats financièrement hyper rentable: ça pouvait sentir le piège. Mais attention, on ne touche pas au monument Zeppelin. Ce qui le sauve? En plus de la démonstration de plus de deux heures que nous offrent Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et Jason Bonham (fils de), ce concert enregistré à l’O2 de Londres il y a cinq ans avait un but caritatif. Classe jusqu’au bout. Point d’envie de faire du blé pour se gaver, donc. Filmé comme pour mieux rendre compte de l’incroyable interaction qui lie les quatre membres d’un des plus grands groupes de l’histoire, « Celebration Day » ose allier sobriété et démonstration, au son survitaminé d’hymnes tels « Ramble on », Black dog », « Stairway to heaven » ou « Whole lotta love ». A lui seul, cet achat de masse presque obligatoire pourrait sauver un support Bluray à la dérive totale.
Led Zeppelin, « Celebration day »: Un live de 2007 en multi-formats financièrement hyper rentable: ça pouvait sentir le piège. Mais attention, on ne touche pas au monument Zeppelin. Ce qui le sauve? En plus de la démonstration de plus de deux heures que nous offrent Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et Jason Bonham (fils de), ce concert enregistré à l’O2 de Londres il y a cinq ans avait un but caritatif. Classe jusqu’au bout. Point d’envie de faire du blé pour se gaver, donc. Filmé comme pour mieux rendre compte de l’incroyable interaction qui lie les quatre membres d’un des plus grands groupes de l’histoire, « Celebration Day » ose allier sobriété et démonstration, au son survitaminé d’hymnes tels « Ramble on », Black dog », « Stairway to heaven » ou « Whole lotta love ». A lui seul, cet achat de masse presque obligatoire pourrait sauver un support Bluray à la dérive totale.
 The Jim Jones Revue, « The savage heart »: Le clin d’oeil est flagrant. Une pochette aux couleurs déprimantes, quatre mecs égarés au pied des usines fumantes de Canvey Island. Canvey Island, un endroit qui devrait devenir lieu de pélerinage punitif à quiconque pense que les Franz Ferdinand ou Muse sont des bêtes de scène. Parce que cette ville, en bout de course d’un estuaire de la Tamise, a vu naître un des plus grands groupes de l’histoire du monde: les Dr Feelgood. Trois premiers albums en autant d’années suivis d’un héritage outrageusement pompé et trop discrètement salué. Les Jim Jones se chargent de nous rafraîchir la mémoire avec le brio et l’énergie qu’on leur connait. Arrivés au stade critique du troisième disque, le groupe londonien – qui traîne légitimement une réputation scénique des plus tonitruante – préfère toujours autant la baston à mains nues ou au tesson. « Savage heart » est presque aussi épileptique que le Wilko Johnson des débuts et tout autant vénéneux qu’un Jerry Lee Lewis au saut du lit.
The Jim Jones Revue, « The savage heart »: Le clin d’oeil est flagrant. Une pochette aux couleurs déprimantes, quatre mecs égarés au pied des usines fumantes de Canvey Island. Canvey Island, un endroit qui devrait devenir lieu de pélerinage punitif à quiconque pense que les Franz Ferdinand ou Muse sont des bêtes de scène. Parce que cette ville, en bout de course d’un estuaire de la Tamise, a vu naître un des plus grands groupes de l’histoire du monde: les Dr Feelgood. Trois premiers albums en autant d’années suivis d’un héritage outrageusement pompé et trop discrètement salué. Les Jim Jones se chargent de nous rafraîchir la mémoire avec le brio et l’énergie qu’on leur connait. Arrivés au stade critique du troisième disque, le groupe londonien – qui traîne légitimement une réputation scénique des plus tonitruante – préfère toujours autant la baston à mains nues ou au tesson. « Savage heart » est presque aussi épileptique que le Wilko Johnson des débuts et tout autant vénéneux qu’un Jerry Lee Lewis au saut du lit.
 Neil Young and Crazy Horse, « Psychedelic Pill »: D’entrée, avec son intro de 27 minutes, le Loner nous montre qu’il n’a pas forcément envie de plaire. Enfin si: à ses fans. En torturant sa Gibson Les Paul légendaire, il arrive encore à sonner comme il y a trente ans. Et c’est tout ce qu’on lui demande! Comme s’il suffisait simplement de gratter sur de vieux instruments pour sonner vintage… Et ce même si dans sa dernière autobiographie en date, il paraît moins mystérieux et profond qu’un Dylan, sa sincérité abordable touche au plus profond et lui permet de faire de grands disques. Over-saturé et le tempo ralenti, ce « Psychedelic Pill » est presque un « Ragged Glory » (1990), mais avec vingt ans de plus, mort et vie du Grunge incluses. Et même si le disque sonne comme une récréation de quelques vieux (au sens monstres sacrés) enfermés dans une grange-studio, le cheveux filasse et entourés de Cadillac vintage (la plus récente doit être de 59), il met tout le monde d’accord.
Neil Young and Crazy Horse, « Psychedelic Pill »: D’entrée, avec son intro de 27 minutes, le Loner nous montre qu’il n’a pas forcément envie de plaire. Enfin si: à ses fans. En torturant sa Gibson Les Paul légendaire, il arrive encore à sonner comme il y a trente ans. Et c’est tout ce qu’on lui demande! Comme s’il suffisait simplement de gratter sur de vieux instruments pour sonner vintage… Et ce même si dans sa dernière autobiographie en date, il paraît moins mystérieux et profond qu’un Dylan, sa sincérité abordable touche au plus profond et lui permet de faire de grands disques. Over-saturé et le tempo ralenti, ce « Psychedelic Pill » est presque un « Ragged Glory » (1990), mais avec vingt ans de plus, mort et vie du Grunge incluses. Et même si le disque sonne comme une récréation de quelques vieux (au sens monstres sacrés) enfermés dans une grange-studio, le cheveux filasse et entourés de Cadillac vintage (la plus récente doit être de 59), il met tout le monde d’accord.
 Rebels of Tijuana, « La bourgeoise »: Ces intrus dans ma liste de Noël, ces mecs que l’on ne connait pas, ont les couilles de faire de bons disques et assument le nom le plus rock’n’roll qui soit, en 2012. Alors quand en plus ceux-ci proposent un Rock yéyé qui évite le piège du minet et vous citent les Byrds en exemple, la branche se brise et on se retrouve sur le cul, bouche-bé, c’est l’heure de la becquée. Avec « La bourgeoise », les Rebels of Tijuana signent un album complètement hors du temps, empruntant tout aussi bien la gouaille d’un Hallyday à tout casser que la classe insolente d’un Nino Ferrer haut perché. En passant de l’anglais au français et en continuant d’oser à tout bout de « chant », les rebelles sont plus que jamais sur la route des grands disques, le tout dans une totale indifférence indé qui nourrit tout leur charme.
Rebels of Tijuana, « La bourgeoise »: Ces intrus dans ma liste de Noël, ces mecs que l’on ne connait pas, ont les couilles de faire de bons disques et assument le nom le plus rock’n’roll qui soit, en 2012. Alors quand en plus ceux-ci proposent un Rock yéyé qui évite le piège du minet et vous citent les Byrds en exemple, la branche se brise et on se retrouve sur le cul, bouche-bé, c’est l’heure de la becquée. Avec « La bourgeoise », les Rebels of Tijuana signent un album complètement hors du temps, empruntant tout aussi bien la gouaille d’un Hallyday à tout casser que la classe insolente d’un Nino Ferrer haut perché. En passant de l’anglais au français et en continuant d’oser à tout bout de « chant », les rebelles sont plus que jamais sur la route des grands disques, le tout dans une totale indifférence indé qui nourrit tout leur charme.
 Sébastien Tellier, « My god is blue »: Sébastien Tellier s’est mis dans le pétrin tout seul. Autant vous le dire tout de suite: son disque n’a pas marché. Pourtant, 13 ans après Paco Rabanne, il avait choisi la bonne année pour jouer les gourous de service. Le génie imposteur s’est donc (trop) servi des médias en amont pour annoncer son nouveau régime à à base de « Pepito bleu ». On adore ou on déteste. Mais si l’on a la chance de vraiment connaître l’élégance discographique des beaux-bizarre (Christophe en tête), on a vite fait de se lasser de Tellier. Malgré tout, « My god is blue » est une jungle bleue impénétrable que l’on éclaircit à grands coups d’acides chamaniques, une Atlantide biscuitée et friable que Tellier nous émiette au-dessus de la tête. Glissant doucement vers une partouze liturgique, sa grande messe groovy se trouve presque honteuse devant tant d’incapacité à rester chaste. Tellier, c’est le padre cool qui s’entoure de débaucheurs comme enfants de coeur, celui qui nous pousse à nous inquiéter avant d’aborder le deuxième degré et qui s’efforce de faire avec les moyens du bord dans une époque où le buzz nous tuera.
Sébastien Tellier, « My god is blue »: Sébastien Tellier s’est mis dans le pétrin tout seul. Autant vous le dire tout de suite: son disque n’a pas marché. Pourtant, 13 ans après Paco Rabanne, il avait choisi la bonne année pour jouer les gourous de service. Le génie imposteur s’est donc (trop) servi des médias en amont pour annoncer son nouveau régime à à base de « Pepito bleu ». On adore ou on déteste. Mais si l’on a la chance de vraiment connaître l’élégance discographique des beaux-bizarre (Christophe en tête), on a vite fait de se lasser de Tellier. Malgré tout, « My god is blue » est une jungle bleue impénétrable que l’on éclaircit à grands coups d’acides chamaniques, une Atlantide biscuitée et friable que Tellier nous émiette au-dessus de la tête. Glissant doucement vers une partouze liturgique, sa grande messe groovy se trouve presque honteuse devant tant d’incapacité à rester chaste. Tellier, c’est le padre cool qui s’entoure de débaucheurs comme enfants de coeur, celui qui nous pousse à nous inquiéter avant d’aborder le deuxième degré et qui s’efforce de faire avec les moyens du bord dans une époque où le buzz nous tuera.
 Crosby, Stills & Nash, « CSN 2012 »: Attention, je vous parle là d’un des plus beaux objets parus cette année. Beau, pour plusieurs raisons. Parce que l’on doit à CSN quelques-uns des disques les plus majestueux des 60’s et des 70’s, parce qu’aujourd’hui on nous parle de Folk et d’harmonies vocales sans même savoir ce que c’est, et que rien que pour son son de gratte, Stephen Stills – encore un génie de la six cordes mésestimé par l’histoire – ici présent mériterait une statue haute comme la tour Eiffel. Bien sur, ce live 2012 s’adresse généralement aux nostalgiques de plus de cinquante ans, mais pour nous les jeunes, comprendre le Rock, c’est aussi et surtout remonter à sa source. Et au vu de ce que CSN arrivent encore à assumer, en terme de voix, de guitare ou de batterie, le voyage dans le temps semble inéluctable.
Crosby, Stills & Nash, « CSN 2012 »: Attention, je vous parle là d’un des plus beaux objets parus cette année. Beau, pour plusieurs raisons. Parce que l’on doit à CSN quelques-uns des disques les plus majestueux des 60’s et des 70’s, parce qu’aujourd’hui on nous parle de Folk et d’harmonies vocales sans même savoir ce que c’est, et que rien que pour son son de gratte, Stephen Stills – encore un génie de la six cordes mésestimé par l’histoire – ici présent mériterait une statue haute comme la tour Eiffel. Bien sur, ce live 2012 s’adresse généralement aux nostalgiques de plus de cinquante ans, mais pour nous les jeunes, comprendre le Rock, c’est aussi et surtout remonter à sa source. Et au vu de ce que CSN arrivent encore à assumer, en terme de voix, de guitare ou de batterie, le voyage dans le temps semble inéluctable.
 Wovenhand, « The laughing stalk »: Wovenhand, c’est l’histoire d’un side-project qui sonne mieux que le groupe original (Sixteen Horsepower) dont les membres sont issus. Vous n’avez jamais eu la chance de les voir en live? Foncez-y. Car se retrouver devant la bande à David Eugene Edwards est une véritable expérience. Plus sombre que les précédents albums, leur « Laughing stalk » accuse un esprit salement animé, pour ne pas dire la noirceur des fleurs fanées. Ce voyage sorcier commence profondément sous terre et ne s’engage pas à nous en montrer plus de la lumière du jour, obscurcie tout du long par un psychédélisme lugubre et les fantômes du Velvet Underground. Wovenhand malaxe la matière grise au cours de ces neuf titres instinctifs et tribaux que l’on emmènerai volontiers en bagages à main aux portes de l’enfer. Une merveille.
Wovenhand, « The laughing stalk »: Wovenhand, c’est l’histoire d’un side-project qui sonne mieux que le groupe original (Sixteen Horsepower) dont les membres sont issus. Vous n’avez jamais eu la chance de les voir en live? Foncez-y. Car se retrouver devant la bande à David Eugene Edwards est une véritable expérience. Plus sombre que les précédents albums, leur « Laughing stalk » accuse un esprit salement animé, pour ne pas dire la noirceur des fleurs fanées. Ce voyage sorcier commence profondément sous terre et ne s’engage pas à nous en montrer plus de la lumière du jour, obscurcie tout du long par un psychédélisme lugubre et les fantômes du Velvet Underground. Wovenhand malaxe la matière grise au cours de ces neuf titres instinctifs et tribaux que l’on emmènerai volontiers en bagages à main aux portes de l’enfer. Une merveille.
 The Stranglers, « Giants »: « Quand on était jeunes, on a tout fait pour ne pas devenir vieux. C’est frustrant d’être encore en vie après avoir tout essayé. De plus, on vit dans une petite époque où il n’y a pas de grandes idées, alors aux vieux schnoks de se rebeller, 60 ans et toujours le poing levé… ». Rois de la provocation, géants de l’imprécation, les Stranglers nous prennent d’entrée à la gorge. Visez la pochette! Une balançoire, quatre cordes, quatre pendus. Violence délibérée sur fond de liberté folle. Emmenés par Jet Black – le batteur de 73 ans! – et la basse de JJ Burnel qui groove, provoque, vrombit et agresse sans cesse, le groupe nargue tout bonnement une jeunesse qui s’est résignée à lui courir après. En tout cela « Giants » est un emmerdeur de première, un revers de la main qui envoie la nouvelle génération se refaire une virilité. A l’aube des check-up et autres tripotages uro-génitaux, les anciens avancent une main dans le froc et le majeur tendu vers le haut. Les Punk, plus ça devient vieux…
The Stranglers, « Giants »: « Quand on était jeunes, on a tout fait pour ne pas devenir vieux. C’est frustrant d’être encore en vie après avoir tout essayé. De plus, on vit dans une petite époque où il n’y a pas de grandes idées, alors aux vieux schnoks de se rebeller, 60 ans et toujours le poing levé… ». Rois de la provocation, géants de l’imprécation, les Stranglers nous prennent d’entrée à la gorge. Visez la pochette! Une balançoire, quatre cordes, quatre pendus. Violence délibérée sur fond de liberté folle. Emmenés par Jet Black – le batteur de 73 ans! – et la basse de JJ Burnel qui groove, provoque, vrombit et agresse sans cesse, le groupe nargue tout bonnement une jeunesse qui s’est résignée à lui courir après. En tout cela « Giants » est un emmerdeur de première, un revers de la main qui envoie la nouvelle génération se refaire une virilité. A l’aube des check-up et autres tripotages uro-génitaux, les anciens avancent une main dans le froc et le majeur tendu vers le haut. Les Punk, plus ça devient vieux…
 Dr John, « Locked down »: Accompagné de Dan Auerbach (des Black Keys) à la production, Dr John se refait une santé. Ce n’est pas tant qu’il en avait besoin, mais si l’on peut faire du neuf avec du vieux, pour quoi ne pas tenter un dernier (?) coup de maître. On sait le plus ancien respecté de tous, fans de blues et jazz confondus, et on découvre chaque fois un peu plus – et au fil de leurs albums – ce que doivent les Black Keys à ces mêmes anciens. Alors, qui a guidé qui, on ne le saura jamais vraiment, mais « Locked Down » finit d’asseoir l’initiateur sur un trône qui fait tout sauf chanceler. La chaleur Soul que dégage le Dr de sa voix vieillissante ne montre aucune faroucherie face au blues râpeux d’Auerbach, sur qui il faudra à priori compter si le Rock envisage encore de faire de grands disques.
Dr John, « Locked down »: Accompagné de Dan Auerbach (des Black Keys) à la production, Dr John se refait une santé. Ce n’est pas tant qu’il en avait besoin, mais si l’on peut faire du neuf avec du vieux, pour quoi ne pas tenter un dernier (?) coup de maître. On sait le plus ancien respecté de tous, fans de blues et jazz confondus, et on découvre chaque fois un peu plus – et au fil de leurs albums – ce que doivent les Black Keys à ces mêmes anciens. Alors, qui a guidé qui, on ne le saura jamais vraiment, mais « Locked Down » finit d’asseoir l’initiateur sur un trône qui fait tout sauf chanceler. La chaleur Soul que dégage le Dr de sa voix vieillissante ne montre aucune faroucherie face au blues râpeux d’Auerbach, sur qui il faudra à priori compter si le Rock envisage encore de faire de grands disques.
 Lee Fields, « Faithful man »: Bien sûr, on ne peut pas s’empêcher de comparer Lee Fields à James Brown, et son surnom, il ne l’a pas volé. Little James Brown est la figure de proue du label Daptone Records, ce label qui nous plonge dans la moiteur des années Soul. A l’écoute de « Faithful man », on s’octroie des bottines cuir à talonnettes et un col pelle à tarte sans broncher, mais aussi et surtout une féroce envie de baiser. Lil’ JB, à travers une voix qui vient de plus loin que le coeur – qui sort des tripes (!) – a la recette pour faire de la musique un instrument de sexualité débridée et estampillée soul, aguicheuse, langoureuse… Accompagné par ses excellents musiciens de The Expressions, Lee Fields est peut-être bien l’artiste à retenir de cette année d’apocalypse. Parce que si l’on doit tous y passer, autant s’amuser…
Lee Fields, « Faithful man »: Bien sûr, on ne peut pas s’empêcher de comparer Lee Fields à James Brown, et son surnom, il ne l’a pas volé. Little James Brown est la figure de proue du label Daptone Records, ce label qui nous plonge dans la moiteur des années Soul. A l’écoute de « Faithful man », on s’octroie des bottines cuir à talonnettes et un col pelle à tarte sans broncher, mais aussi et surtout une féroce envie de baiser. Lil’ JB, à travers une voix qui vient de plus loin que le coeur – qui sort des tripes (!) – a la recette pour faire de la musique un instrument de sexualité débridée et estampillée soul, aguicheuse, langoureuse… Accompagné par ses excellents musiciens de The Expressions, Lee Fields est peut-être bien l’artiste à retenir de cette année d’apocalypse. Parce que si l’on doit tous y passer, autant s’amuser…
 Dinosaur Jr, « I bet on sky »: Quand il est au complet et dans sa formation d’origine, Dinosaur Jr est un groupe qui ne baisse pas de niveau. Le genre qu’il emprunte vieillit, ça oui, mais la grande force de Lou Barlow, Jay Mascis et Murph est de nous bluffer, à croire que leur noise-rock est né hier, dans l’existence morne d’une bande de glandeurs de Boston. Noyée dans la distorsion et la mélancolie, la musique de Dinosaur Jr n’a jamais changé. « I bet on sky » respire la simplicité que les Smashing Pumpkins (pour ne citer qu’eux) n’ont pas su garder, et souffle un vent 90′s qui affiche certes des contours consanguins, mais aussi et surtout un talent indéniablement intact, à l’image d’une succession de (leurs) disques qui, une fois additionnés, donnent envie de détester tout le monde et d’être un plouc, d’être Grunge en somme.
Dinosaur Jr, « I bet on sky »: Quand il est au complet et dans sa formation d’origine, Dinosaur Jr est un groupe qui ne baisse pas de niveau. Le genre qu’il emprunte vieillit, ça oui, mais la grande force de Lou Barlow, Jay Mascis et Murph est de nous bluffer, à croire que leur noise-rock est né hier, dans l’existence morne d’une bande de glandeurs de Boston. Noyée dans la distorsion et la mélancolie, la musique de Dinosaur Jr n’a jamais changé. « I bet on sky » respire la simplicité que les Smashing Pumpkins (pour ne citer qu’eux) n’ont pas su garder, et souffle un vent 90′s qui affiche certes des contours consanguins, mais aussi et surtout un talent indéniablement intact, à l’image d’une succession de (leurs) disques qui, une fois additionnés, donnent envie de détester tout le monde et d’être un plouc, d’être Grunge en somme.
Gyslain Lancement

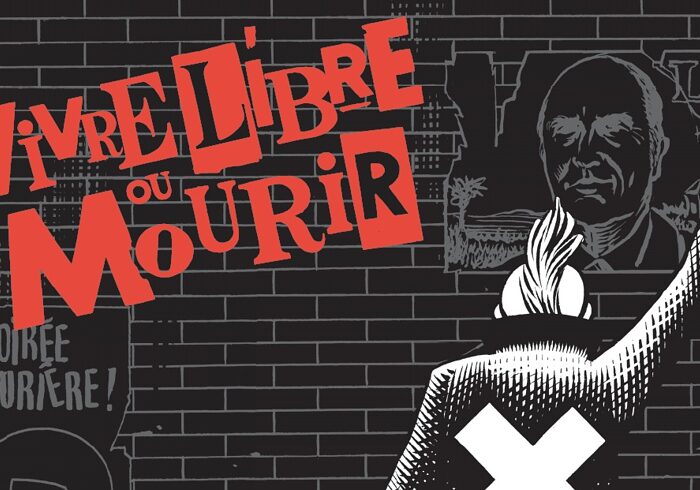


Laisser un commentaire