Eric Constantin est connu pour être un showman. Et c’est déjà pas mal. Pas évident pour autant, car ça nécessite une grande intelligence, une grosse capacité d’improvisation et une spontanéité à toute épreuve. En côtoyant Eric ces dernières semaines, je me suis marré, surpris à aimer son franc parlé et à comprendre l’artiste face au doute, l’artiste en proie à la dure réalité du marché, aux questions que l’on se pose quand on est chanteur dans une société mollassonne. Les gens devraient comprendre que c’est la galère de faire de la musique, que plus tu t’approches d’un rêve de gosse et plus c’est difficile. Par exemple, astronaute ou navigateur c’est chiant, tu fais des études, tu gerbes toute la journée, tu bouffe de la nourriture lyophilisée… c’est d’la merde a faire! Alors tu te dis que tu vas faire acteur, mais tu dois te taper des castings pourris, des pubs d’entreprises moisies… Alors il te reste chanteur, et c’est dur aussi. Plus tu as envie de devenir Paul Mccartney, plus tu te mets à penser que c’était plus facile d’être éboueur. Ceci dit, tu peux être éboueur et t’appeler Muse, récolter toutes les ordures de Queen ou Generis, les recycler, et remplir des stades avec (rires)!
 A trente ans, on peu prendre son temps pour faire un disque, c’est même conseillé, car outre le fait de continuer à faire ses preuves, l’âge d’homme n’a rien d’ultra pressant, musicalement parlant. Pour cet album j’ai pris beaucoup de temps, histoire de faire un truc satisfaisant pour tous. Je n’avais pas d’urgence du tout, j’avais juste envie de faire passer un message correctement. Et au final, les chansons ont toutes voulu dire quelquechose à chacun des membres du groupe. Car ça a été un vrai travail de « band ». Un « E Street Band » du coin. « E » pour Ependes. L’atout de mon album c’est la complémentarité de mes musiciens, on savait tous ce que l’on avait à faire. Tu sais, sans mes musiciens, je ne suis qu’un petit connard qui fait des chansons à la guitare… Mon exemple c’est Springsteen. Le truc qui me rassure, c’est de me demander qu’est-ce que le Boss ferait. C’est une continuité que les gens ne sentent pas forcement mais qui habite mon esprit tous les jours. Je suis bien sûr parti avec une interrogation: « ce que j’ai fait avant est-il ce que j’ai fait de mieux? » Avec le recul et la maturité artistique, tu pointes le doigt sur les différences, et j’estime que mes disques sont un peu hors d’époque, dans aucun mouvement, et de toute façon, ça n’est pas possible de faire des albums en se fixant là-dessus. On lui glissera ainsi l’anecdote toute Jerry Lee Lewissienne qui déclarait, il n’y a pas si longtemps: « ça n’est pas moi qui me suit trompé, ce sont les époques ». Ce cher Jerry Lee! Le gars qui a quand même marié sa cousine de 13 ans et qui a voulu tuer Elvis parce qu’il avait soi-disant piqué la musique aux noirs! Mais malgré tout, son boogie est éternel car c’est le sien. Il a raison d’en avoir rien à foutre. Il n’y a aucune inquiétude à avoir au vieillissement, au contraire, c’est du cachet. Il n’y avait pas de logique commerciale à la base, aucune envie de circonscrire une époque, et voilà le résultat: on le surnomme encore et toujours le Killer!
A trente ans, on peu prendre son temps pour faire un disque, c’est même conseillé, car outre le fait de continuer à faire ses preuves, l’âge d’homme n’a rien d’ultra pressant, musicalement parlant. Pour cet album j’ai pris beaucoup de temps, histoire de faire un truc satisfaisant pour tous. Je n’avais pas d’urgence du tout, j’avais juste envie de faire passer un message correctement. Et au final, les chansons ont toutes voulu dire quelquechose à chacun des membres du groupe. Car ça a été un vrai travail de « band ». Un « E Street Band » du coin. « E » pour Ependes. L’atout de mon album c’est la complémentarité de mes musiciens, on savait tous ce que l’on avait à faire. Tu sais, sans mes musiciens, je ne suis qu’un petit connard qui fait des chansons à la guitare… Mon exemple c’est Springsteen. Le truc qui me rassure, c’est de me demander qu’est-ce que le Boss ferait. C’est une continuité que les gens ne sentent pas forcement mais qui habite mon esprit tous les jours. Je suis bien sûr parti avec une interrogation: « ce que j’ai fait avant est-il ce que j’ai fait de mieux? » Avec le recul et la maturité artistique, tu pointes le doigt sur les différences, et j’estime que mes disques sont un peu hors d’époque, dans aucun mouvement, et de toute façon, ça n’est pas possible de faire des albums en se fixant là-dessus. On lui glissera ainsi l’anecdote toute Jerry Lee Lewissienne qui déclarait, il n’y a pas si longtemps: « ça n’est pas moi qui me suit trompé, ce sont les époques ». Ce cher Jerry Lee! Le gars qui a quand même marié sa cousine de 13 ans et qui a voulu tuer Elvis parce qu’il avait soi-disant piqué la musique aux noirs! Mais malgré tout, son boogie est éternel car c’est le sien. Il a raison d’en avoir rien à foutre. Il n’y a aucune inquiétude à avoir au vieillissement, au contraire, c’est du cachet. Il n’y avait pas de logique commerciale à la base, aucune envie de circonscrire une époque, et voilà le résultat: on le surnomme encore et toujours le Killer!
Si le titre de son troisième album, « L’amour du vertige », invite à un facile parallèle avec son homologue inversé signé Alain Bashung, c’est plus un Bénabar ou un Souchon que l’on reconnaît si l’on prend le temps de creuser les douze titres qui le composent. Bashung, c’est à la fois pop et compliqué, quant à Bénabar, il m’influençait plus avant. Je l’aime bien, c’est un mec qui suit un peu Renaud, avec le même genre d’humour et la picole en moins. Je n’écoute pas forcément ses disques mais à chaque fois que je vais le voir en concert, j’ai la sensation de retrouver un vieux pote. Par contre, Souchon a ce coté simple et poétique qui me parle, sans tomber dans le pathos. Mon truc à moi, c’est le texte universel sans métaphoriser, avec un recul humoristique, avec des mots simples et différents. Dans le triste, l’idée ne me viendrait pas de copier Bashung mais plutôt des chanteurs folk américains ou un « Nebraska » de Bruce Springsteen. J’aime aussi beaucoup Thierry Romanens avec qui on partage une certaine aisance à parler au public, parler en étant drôle à ceux qui viennent te voir avec de la réjouissance plein les yeux. En décalage avec l’humour naturel qui caractérise son auteur – et qui pourrait en faire un figurant sérieux aux pitreries smart de type Kaamelott – les textes de « L’amour du vertige » évoquent la solitude, le temps qui passe et se paient même deux hommages bien différents: l’un à un avatar imaginaire d’Elvis Presley (« 1935-1977 »), l’autre au philosophe valaisan Alexandre Jollien (« Le feu d’artifice »). Ce sont des trucs que j’ai fait pour que les fans se posent la question: « mais de qui il parle? ». La philo ne m’intéresse pas, et pourtant ce personnage de Jollien a cette faculté, cet handicap physique (il est atteint d’athétose qui l’empêche de s’exprimer normalement à l’oral) qui lui fait parler de l’esprit comme personne, un enfermement, une solitude surprenante et foutrement intéressante. Une fois que tu es libéré de ce que les gens pensent de toi, ça devient intéressant. Ce qui
composent. Bashung, c’est à la fois pop et compliqué, quant à Bénabar, il m’influençait plus avant. Je l’aime bien, c’est un mec qui suit un peu Renaud, avec le même genre d’humour et la picole en moins. Je n’écoute pas forcément ses disques mais à chaque fois que je vais le voir en concert, j’ai la sensation de retrouver un vieux pote. Par contre, Souchon a ce coté simple et poétique qui me parle, sans tomber dans le pathos. Mon truc à moi, c’est le texte universel sans métaphoriser, avec un recul humoristique, avec des mots simples et différents. Dans le triste, l’idée ne me viendrait pas de copier Bashung mais plutôt des chanteurs folk américains ou un « Nebraska » de Bruce Springsteen. J’aime aussi beaucoup Thierry Romanens avec qui on partage une certaine aisance à parler au public, parler en étant drôle à ceux qui viennent te voir avec de la réjouissance plein les yeux. En décalage avec l’humour naturel qui caractérise son auteur – et qui pourrait en faire un figurant sérieux aux pitreries smart de type Kaamelott – les textes de « L’amour du vertige » évoquent la solitude, le temps qui passe et se paient même deux hommages bien différents: l’un à un avatar imaginaire d’Elvis Presley (« 1935-1977 »), l’autre au philosophe valaisan Alexandre Jollien (« Le feu d’artifice »). Ce sont des trucs que j’ai fait pour que les fans se posent la question: « mais de qui il parle? ». La philo ne m’intéresse pas, et pourtant ce personnage de Jollien a cette faculté, cet handicap physique (il est atteint d’athétose qui l’empêche de s’exprimer normalement à l’oral) qui lui fait parler de l’esprit comme personne, un enfermement, une solitude surprenante et foutrement intéressante. Une fois que tu es libéré de ce que les gens pensent de toi, ça devient intéressant. Ce qui  m’attire c’est la solitude qui n’est pas évidente, c’est le chanteur abandonné d’Hallyday quoi. Parce que lorsque tu penses a un chanteur, tu ne penses pas forcement a un mec seul, et ça met en lumière une sorte de solitude que tu ne connaissais pas. Concernant Presley, j’avoue que cette idée m’est venue il y a 3-4 ans et j’imaginais la vie d’un Elvis sans la musique mais plutôt sous la forme d’une nouvelle et non d’une chanson. Cette chanson c’est comme si on regardait ces dates sur la tombe, et moi je parlerais comme un nouvelliste de tout le reste, rien de ce qu’il y a eu entre 1935 et 1977. J’imaginais un hôtel ou il n’y aurait que des mecs que tu crois morts, mais qui en fait ne le sont pas, et tu les découvrais sans savoir que c’était eux. Parce que je trouve qu’il n’y a rien de plus frustrant que de perdre quelqu’un comme Elvis, Jimi Hendrix ou Janis Joplin! Concernant Elvis, son « métier » lui bouffait son existence, il ne se rendait pas compte ni de son temps ni de son époque, alors qu’il avait été son temps et son époque à la fin des années 50. En plus, au contraire de Johnny Cash parti de manière digne, Elvis n’a pas eu le temps de faire son testament musical, il est mort comme une merde gavée de tout. Finalement, parler d’Elvis ou Jollien, ça élève un peu.
m’attire c’est la solitude qui n’est pas évidente, c’est le chanteur abandonné d’Hallyday quoi. Parce que lorsque tu penses a un chanteur, tu ne penses pas forcement a un mec seul, et ça met en lumière une sorte de solitude que tu ne connaissais pas. Concernant Presley, j’avoue que cette idée m’est venue il y a 3-4 ans et j’imaginais la vie d’un Elvis sans la musique mais plutôt sous la forme d’une nouvelle et non d’une chanson. Cette chanson c’est comme si on regardait ces dates sur la tombe, et moi je parlerais comme un nouvelliste de tout le reste, rien de ce qu’il y a eu entre 1935 et 1977. J’imaginais un hôtel ou il n’y aurait que des mecs que tu crois morts, mais qui en fait ne le sont pas, et tu les découvrais sans savoir que c’était eux. Parce que je trouve qu’il n’y a rien de plus frustrant que de perdre quelqu’un comme Elvis, Jimi Hendrix ou Janis Joplin! Concernant Elvis, son « métier » lui bouffait son existence, il ne se rendait pas compte ni de son temps ni de son époque, alors qu’il avait été son temps et son époque à la fin des années 50. En plus, au contraire de Johnny Cash parti de manière digne, Elvis n’a pas eu le temps de faire son testament musical, il est mort comme une merde gavée de tout. Finalement, parler d’Elvis ou Jollien, ça élève un peu.
On en vient ensuite au terrain de jeu d’Eric, la scène, son lieu de prédilection rien qu’à lui, le showman. Il se pourrait bien que ce mec-là soit né par une nuit d’orage et poursuive une voie qui se construit à travers quelques bouquins essentiels et une fanitude inconditionnelle à Bruce Springsteen, avec un gros soupçon d’Hallyday période 1968-2000. J’ai une grande admiration pour les mecs de scène. Que ce soit Springsteen, mon idole absolu, Hallyday ou même Robbie Williams. Parce qu’attention, les mecs ne sont pas là par hasard, et ils n’ont pas le charisme d’un beignet non plus! De toute façon, les mecs qui font des shows pourris ne durent pas. Capter l’attention. Voilà ce qu’Eric sait faire de mieux. Eric en concert, c’est un voyage au pays des vivants. Moi ce que j’aime, c’est quand les gens s’amusent. Je ne fais pas ce métier pour l’enregistrer, le formater ou le figer. On aurait tous envie d’être Bruce Springsteen. Un live du Boss, ça calme tout le monde! Peut-être que ma musique est moins bien que n’importe qui d’autre, mais par contre, quand tu viens me voir en concert, tu te prends une claque de fun.
Conscient et agacé par les limites banalisées de vivre avec l’étiquette de chanteur Suisse, Eric a le constat amer, en plus d’une théorie bien précise sur la question. C‘est difficile a expliquer… Les chanteurs Suisses sont tous considérés un jour et à différents niveaux comme le « man next door », le gars à qui l’on tapote l’épaule en disant « c’est super », c’est gentillet quoi. A terme, cette proximité  Suisse n’est pas forcément bénéfique, on est plus en difficulté car le public pense que l’on va tous être là sans forcément s’investir beaucoup. Quel artiste Suisse marche bien en dehors du pays? Personne. Allez, Sophie Hunger. Stéphane Eicher? Oui, mais on a oublié qu’il était Suisse. Bastian Baker? C’est hyper bien produit, c’est d’ailleurs pour ça que beaucoup le détestent facilement, mais sa pop en anglais léchée et légère a l’avantage de ne marcher sur les plates bandes de personnes en Romandie, et en plus il participe à « Danse avec les stars » (rires). Après avoir tenté ensemble d’américaniser son patronyme, Ricky Constantine se lâche, ironiquement. Il y a deux choses qu’il faut avoir pour être chanteur: le premier package, c’est vivre une vie de merde, être moche, galerer sentimentalement, être original mais dans le mauvais sens du terme, ne pas avoir de gonzesse et en vouloir à l’amour, etc… La 2eme chose c’est le nom américain, Paul Mac Bonvin par exemple (rires)… Non, restons sur Bastian Baker, qui n’a pas la chance d’être moche, qui a toutes les jeunes nanas qu’il veut, une vie amoureuse qu’on imagine puritaine à la Dawson… On s’attaque ensuite à la question de la promo, à l’heure où plus personne ne joue vraiment le jeu, par dépit, par découragement ou manque de matière brute, le marché décrépit en même temps que le métier de journaliste dépérit. Les artistes Suisses souffrent d’un complexe un peu imaginaire. Dans la conscience collective, ça n‘est pas normal qu’un Suisse fasse bien, on subit une concurrence un peu en décalage. A contrario, les mecs obligés de provoquer pour vendre leur propos, comme Damien Saez, m’emmerdent un peu. Saez, c’est un programme politique sur une musique de Noir Désir, et c’est très très chiant…
Suisse n’est pas forcément bénéfique, on est plus en difficulté car le public pense que l’on va tous être là sans forcément s’investir beaucoup. Quel artiste Suisse marche bien en dehors du pays? Personne. Allez, Sophie Hunger. Stéphane Eicher? Oui, mais on a oublié qu’il était Suisse. Bastian Baker? C’est hyper bien produit, c’est d’ailleurs pour ça que beaucoup le détestent facilement, mais sa pop en anglais léchée et légère a l’avantage de ne marcher sur les plates bandes de personnes en Romandie, et en plus il participe à « Danse avec les stars » (rires). Après avoir tenté ensemble d’américaniser son patronyme, Ricky Constantine se lâche, ironiquement. Il y a deux choses qu’il faut avoir pour être chanteur: le premier package, c’est vivre une vie de merde, être moche, galerer sentimentalement, être original mais dans le mauvais sens du terme, ne pas avoir de gonzesse et en vouloir à l’amour, etc… La 2eme chose c’est le nom américain, Paul Mac Bonvin par exemple (rires)… Non, restons sur Bastian Baker, qui n’a pas la chance d’être moche, qui a toutes les jeunes nanas qu’il veut, une vie amoureuse qu’on imagine puritaine à la Dawson… On s’attaque ensuite à la question de la promo, à l’heure où plus personne ne joue vraiment le jeu, par dépit, par découragement ou manque de matière brute, le marché décrépit en même temps que le métier de journaliste dépérit. Les artistes Suisses souffrent d’un complexe un peu imaginaire. Dans la conscience collective, ça n‘est pas normal qu’un Suisse fasse bien, on subit une concurrence un peu en décalage. A contrario, les mecs obligés de provoquer pour vendre leur propos, comme Damien Saez, m’emmerdent un peu. Saez, c’est un programme politique sur une musique de Noir Désir, et c’est très très chiant…
On parcours ensuite un très gros bouquin sur Hallyday, où chaque anecdote merite un marque-page et où Eric s’arrête sur chaque détail que la majorité des lecteurs ne voient pas. « Sang pour sang », il fallait avoir des couilles en 2000 pour sortir un vinyle transparent! Voilà aussi un disque qui m’a  marqué, Bercy 87, et qui commençait par « Rock’n’roll attitude » au piano! Johnny avait du apprendre trois accords spécialement pour la tournée (rires)… Puis Eric s’émotionne, « A propos de mon père » sur un album de 1974, une chanson incroyable! Je ne connaissais pas mon père non plus, ça m’a touché et très attaché à Johnny en fait… Avant d’enchaîner « J’ai pleuré sur ma guitare » seul à la gratte entre le café et le dessert, puis en se projetant sur les dix ans à venir. Tu sais, je suis très complexé par ma musique. Quand je vais voir un show, il y a toujours une partie de moi qui me dit que ma musique est merdique. Et puis, avoir des icônes c’est très handicapant. Aujourd’hui je te cite des artistes comme influence que je ne citerai pas dans mon prochain disque, comme Aubert ou Raphael, car si tu n’évolues pas, ça t’empêche de voir le cap. Il n’y en a qu’un seul qui sera toujours avec moi, c’est le Boss. Où je serais dans dix ans? Je n’en sais rien. Soit j’aurais tout arreté et je regarderai mon parcours avec un point de vue extérieur, je verrais peut-être les gens me regretter ou au contraire être content que je sois parti; soit j’aurai continué a faire de la musique avec la grosse envie d’être reconnu en Suisse, c’est très important pour moi. Que l’on ne me prenne pas au sérieux, ça me fait chier… En tout cas, je veux essayer d’être au plus près de ce que je pense et de ce que je suis, savoir ce que je vaux pour pouvoir faire ce que je veux faire. Un livre m’a énormément marqué à ce propos, « Juliet naked », de l’excellent romancier Nick Hornby. C’est l’histoire d’une ex-icône éphémère qui reprend vie à travers des courriers. Après, je ne veux pas passer pour un mec qui ne s’aime pas, mais c’est quant meme un peu ça.. Ayant vu Eric Constantin capter l’attention d’un public ébahit deux heures quinze durant, on ne comprendra pas ça comme ça. Et on sait déjà que la musique vivra. Un peu grâce à lui.
marqué, Bercy 87, et qui commençait par « Rock’n’roll attitude » au piano! Johnny avait du apprendre trois accords spécialement pour la tournée (rires)… Puis Eric s’émotionne, « A propos de mon père » sur un album de 1974, une chanson incroyable! Je ne connaissais pas mon père non plus, ça m’a touché et très attaché à Johnny en fait… Avant d’enchaîner « J’ai pleuré sur ma guitare » seul à la gratte entre le café et le dessert, puis en se projetant sur les dix ans à venir. Tu sais, je suis très complexé par ma musique. Quand je vais voir un show, il y a toujours une partie de moi qui me dit que ma musique est merdique. Et puis, avoir des icônes c’est très handicapant. Aujourd’hui je te cite des artistes comme influence que je ne citerai pas dans mon prochain disque, comme Aubert ou Raphael, car si tu n’évolues pas, ça t’empêche de voir le cap. Il n’y en a qu’un seul qui sera toujours avec moi, c’est le Boss. Où je serais dans dix ans? Je n’en sais rien. Soit j’aurais tout arreté et je regarderai mon parcours avec un point de vue extérieur, je verrais peut-être les gens me regretter ou au contraire être content que je sois parti; soit j’aurai continué a faire de la musique avec la grosse envie d’être reconnu en Suisse, c’est très important pour moi. Que l’on ne me prenne pas au sérieux, ça me fait chier… En tout cas, je veux essayer d’être au plus près de ce que je pense et de ce que je suis, savoir ce que je vaux pour pouvoir faire ce que je veux faire. Un livre m’a énormément marqué à ce propos, « Juliet naked », de l’excellent romancier Nick Hornby. C’est l’histoire d’une ex-icône éphémère qui reprend vie à travers des courriers. Après, je ne veux pas passer pour un mec qui ne s’aime pas, mais c’est quant meme un peu ça.. Ayant vu Eric Constantin capter l’attention d’un public ébahit deux heures quinze durant, on ne comprendra pas ça comme ça. Et on sait déjà que la musique vivra. Un peu grâce à lui.
Gyslain Lancement



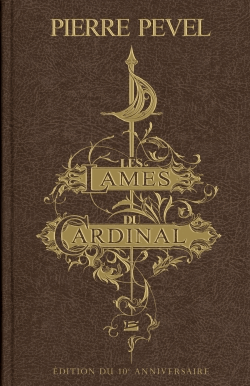

Laisser un commentaire