Le journalisme, la review, le report – appelez-ça comme vous voulez – est un combat. Le gonzo en est un autre. Alors autant vous le dire tout de suite: je suis pour l’hyper-subjectivité. On a tout entendu, tout lu, en février dernier, au moment de la sortie de « Wrecking Ball », vingtième album du Boss. En voilà un qui porte bien son surnom. A 63 ans, habituellement âge du début de tassement et de l’engourdissement, Bruce Springsteen, lui, explose. Aux derniers courageux lecteurs qui lisent encore Rolling Stone Mag, Rock’n’folk ou Mojo, on aurait voulu leur mettre sous le nez les faux éloges et autres rembourrages mielleux d’une presse locale certes populaire, à défaut de mieux, mais largement dépassée par la fougue d’un gamin-rockeur sexagénaire. Un concert ou un album du Boss sont une immersion dans ce genre de moments duquel vous sortez changé, peut-être parce qu’humblement, Springsteen donne la leçon sans forcer son talent ni son tempérament. Manque plus qu’à lui vouer un culte à la hauteur, on ne sait jamais, de là-haut on en saura peut-être davantage.
C’est ainsi qu’en toute modestie, la vénération Springsteen existe depuis plus de trente ans, renforcée par cette réunion du E Street Band datée de 1999. Hier, en quelques sorte. Quand d’autres groupes accusent le coup, le E Street, malgré les départs forcés (notamment la disparition du saxophoniste Clarence Clemons en 2011 ici brillamment remplacé par son neveu Jake Clemons), paraît plus juvénile que jamais, en copié-collé bonifié d’un « Born in the USA tour » (1984), pour lui trouver un exemple lointain et trentenaire. « Born in the USA », titre souvent mal utilisé et incompris, tous ceux qui le considèrent encore comme un chant patriotique sont priés de quitter le stade sur le champ, une bonne fois pour toutes. Déçu par Reagan, outré par G. W. Bush, utilisé par des cons… Et puis quoi encore? Bruce en a souffert, mais, après avoir bravé les tempêtes, peut en être fier. On était 30 000 à le savoir, hier soir. Et comme à chaque fois, on s’apprêtait à passer un des plus beaux instants de notre vie.
Au métier, Bruce a d’entrée balayé toute chance de s’ennuyer. Un début audacieux, qui n’a pas eu le temps de surprendre et fait de suite et en 3″10 le tri parmi les inconditionnels (« Don’t look back »). Entre classiques intercalés (« Badlands », « Ties that bind », « Youngstown », « The River », « Johnny 99 ») parmi les derniers arrivés (« We take care of our own », « Wrecking ball », « Death to my hometown », Jack of all trades », « Shackled and drawn », « Land of hopes and dreams ») on a eu droit à de belles surprises (« The Rising », « If i should fall behind ») et aux traditionnels caprices des premier rang, pancartes à l’appui (« Working on a dream », « Growin’up », « Save my love »). Aucun répit ne sera autorisé. Le stade s’illumine, magnifique, un rappel sans même quitter la scène, insolite, et le début d’une récréation de 40 minutes où la fibre Rock’n’roll sera diablement exploitée (« Seven nights to rock », « Dancing in the dark », et le final en « Twist and shout ») grâce à un quasi-killer aux claviers (Roy Bittan) et un Bruce des plus remontés (« Born in the USA », « Born to run »). Que peut-on reprocher à Bruce Springsteen, au sortir de ces 3h30 de concert? Rien. Mais s’il te plaît Boss, ne mets pas dix ans à revenir en Suisse. Le temps passe vite.
Gyslain Lancement


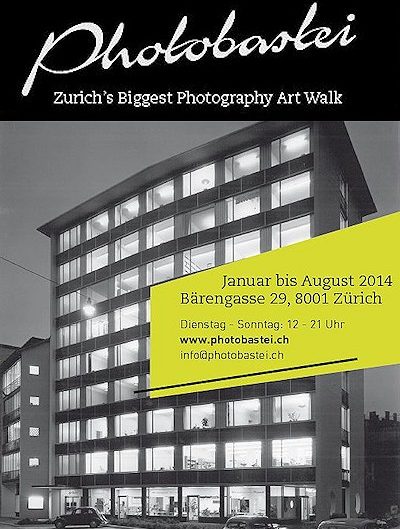
Laisser un commentaire