 La presse Rock, en général, nous laisserait facilement dériver vers la conclusion facile: Jack White, album solo et corbeau sur l’épaule, sont partout. Mais peut-on parler de classique instantané? La réponse est non. Ses Whites Stripes ont déjà fait le boulot. Cette fois, sa séparation artistique d’avec Meg White lui portera-t-elle préjudice? Lui coûterait-elle plus cher que prévu? La monnaie d’une pièce que Jack n’a pas fini de tourner entre ses doigts… Magiques, électriques, éclectiques, des doigts que le Rock croyait avoir perdu, dans un style musical différent, depuis la mort de Kurt Cobain. Musicien accompli mais aussi producteur de l’impossible – il est à la tête de son label Third Man Records – Jack White réinvente l’industrie du disque à sa manière, ou plutôt, la retient d’avaler sa langue. D’autres se sont étouffés avant lui, avant même d’imaginer prétendre que le Vinyle subsisterait au compact disc prétentieux. Fallait pas vendre la peau microsillonnée…
La presse Rock, en général, nous laisserait facilement dériver vers la conclusion facile: Jack White, album solo et corbeau sur l’épaule, sont partout. Mais peut-on parler de classique instantané? La réponse est non. Ses Whites Stripes ont déjà fait le boulot. Cette fois, sa séparation artistique d’avec Meg White lui portera-t-elle préjudice? Lui coûterait-elle plus cher que prévu? La monnaie d’une pièce que Jack n’a pas fini de tourner entre ses doigts… Magiques, électriques, éclectiques, des doigts que le Rock croyait avoir perdu, dans un style musical différent, depuis la mort de Kurt Cobain. Musicien accompli mais aussi producteur de l’impossible – il est à la tête de son label Third Man Records – Jack White réinvente l’industrie du disque à sa manière, ou plutôt, la retient d’avaler sa langue. D’autres se sont étouffés avant lui, avant même d’imaginer prétendre que le Vinyle subsisterait au compact disc prétentieux. Fallait pas vendre la peau microsillonnée…
Ce « Blunderbuss« , lui l’annonce comme un accident, les fans y voient plus une bénédiction; le vicieux, lui, prend la perche, et du coin de l’oeil observe comment Jack peut encore s’en sortir seul. J’appartiens à cette dernière catégorie. Notre exigence alliée à l’héritage des White Stripes feraient-ils de « Blunderbuss » un album moyen? Si l’on ne s’amuse pas à chercher de signification propre à son tromblon de titre, très certainement. Car par définition, le tromblon, arme réglementaire de tout pèlerin digne de ce nom et qui se charge difficilement par la bouche comme on gaverai une oie sauvage, permettait au médiocre de toucher sa cible par déflagration, laissant le plus de traces possibles: le rêve inespéré des experts d’aujourd’hui, une chasse aux oeufs inouïe si spécialiste en balistique il y avait eu au XVIIème. Là encore, les White Stripes ont déjà marqué le terrain. Il aura certes fallu du temps pour s’en rendre compte, de l’abnégation dans certains cas, à se boucher les oreilles devant la beaufitude footballistique s’appropriant sans reconnaissance valable leur « Seven nation army ». Po! Polo-po-po-po po. A dire vrai, Jack White a l’air de s’en foutre. Tour à tour chanteur, guitariste (au sein des Raconteurs) ou batteur (avec Dead Weather), figure de proue, effacé ou producteur, Jack a toujours su quoi faire de ses dix doigts. Seul, ou accompagné. White s’amuse, se redécouvre, parle à ses inconditionnels différemment (« Love interruption »), ceux-là même qui s’amusent plus sur un « White blood cells »(2001), un « De stijl » (2001) ou un « Elephant » (2003), disques déjà vieux mais ô combien utiles dans le cas présent. L’ex-gosse un peu paumé de Detroit – ayant migré à Nashville pour les besoins du Rock? – accole de l’aventure au hasard cérébral qui l’a poussé à faire cet album solo: un Jack White peut en cacher un autre. Cet hyperactif qui voue son entière fidélité au blues se fait plus intime (« Hypocritical kiss ») et moins tranchant (« Missing pieces »). Pour preuve, « Blunderbuss » est couvert de claviers, tantôt boogie (« Hip poor boy », « Trash tongue talker », « I’m shakin' »), tantôt woogie (« Weep themselves to sleep »), parce qu’il fallait bien de la « nouveauté », éclipsée 2 minutes 37 durant par une nostalgie significative et oxygénante (« Sixteen saltines »).
Avec un temps d’avance sur ses compères des Black Keys, Jack White est le garant d’une nouvelle toute puissance, une force indé qui prend peu à peu le pouvoir et qui permet à quelques cadavres de sortir de leur bar (sa récente collaboration avec Tom Jones est époustouflante). Suffisant pour changer ses amis en ennemis? Sans rancunes Jacky, on préfèrera rester sur tes vieux acquis, ceux qui dépassaient sans vergogne la ligne blanche. Et au risque de sentir la poussière, c’est dans les vieux Allman Brothers que le blues est encore le meilleur…
Gyslain Lancement

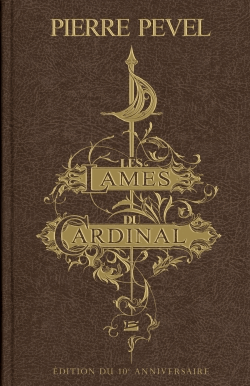

Laisser un commentaire