 Le noir complet. Quelques notes de musique. Deux mots à la typographie glaciale. La lumière s’allume. Tutu, ballerines et maquillage de nacre. Nina arrive sur scène. Le blanc qu’elle revêt rayonne et transperce l’étouffante obscurité. Ses bras tranchent divinement chaque molécule d’air qu’ils rencontrent. Ses pieds quittent le sol et s’envolent avec une facilité déconcertante, avant de retomber telles deux plumes sur la surface d’un lac. Tout son corps est habité par les vibrations. Tchaïkovsky respire à travers elle. Ses mouvements découvrent des émotions jusqu’alors inédites. Le cygne blanc n’est plus un fantasme, il prend corps et s’élève à chaque variation de l’orchestre. La beauté remplit l’écran et fait de nous son esclave.
Le noir complet. Quelques notes de musique. Deux mots à la typographie glaciale. La lumière s’allume. Tutu, ballerines et maquillage de nacre. Nina arrive sur scène. Le blanc qu’elle revêt rayonne et transperce l’étouffante obscurité. Ses bras tranchent divinement chaque molécule d’air qu’ils rencontrent. Ses pieds quittent le sol et s’envolent avec une facilité déconcertante, avant de retomber telles deux plumes sur la surface d’un lac. Tout son corps est habité par les vibrations. Tchaïkovsky respire à travers elle. Ses mouvements découvrent des émotions jusqu’alors inédites. Le cygne blanc n’est plus un fantasme, il prend corps et s’élève à chaque variation de l’orchestre. La beauté remplit l’écran et fait de nous son esclave.
Mais dans ces moments exquis, lorsque le temps semble s’être arrêté, les ténèbres restent toujours aux aguets. Et c’est alors qu’un danseur en justaucorps noir sort des ombres. La caméra ne s’arrête pas de bouger pour autant. La danse est lancée et rien ne peut l’arrêter. L’image continue de tourner autour des protagonistes, épousant chacun des gestes du cygne blanc. Le duo est bref. Nos yeux restent rivés sur la beauté envoutante de Nina, l’autre danseur n’étant là que quelques instants pour rehausser d’un ultime cran le charisme du cygne. La caméra tourne autour de la danseuse en transe et nous dévoile son dos aux os saillants. Hypnotisés, nous ne voyons rien venir. Et lorsque l’image revient sur elle, une gigantesque ombre emplumée est posée derrière son épaule. Un corbeau d’un noir intense l’encercle de ses immenses ailes. Sans attendre, Nina se délivre et un duel des sens débute. Qui du blanc ou du noir saura trouver la force nécessaire pour ne pas succomber ?
Black Swan. Deux mots qui résonnent à nos oreilles comme une promesse trop longtemps attendue. Deux mots qui prédisent le retour de Darren Aronofsky, l’enfant prodige du cinéma américain. Deux mots qui se font l’écho d’une filmographie brève, mais exemplaire. Deux mots qui annoncent la rencontre au sommet de Nathalie Portman et de Vincent Cassel. Bref, deux mots qui nous font trépigner d’impatience et de bonheur pré-exalté. Car, en seulement quatre films, Darren Aronofsky a su développer une vision unique et un langage propre. A chaque film, il a su se réinventer et expérimenter plusieurs styles et thématiques, toujours dans l’optique de repousser d’un cran supplémentaire les limites du septième art. Ainsi, après le thriller mathématique de Pi, le bad-trip graphique de Requiem for a dream, la romance new-age de The fountain et la rédemption quasi-documentaire de The wrestler, Aronofsky se lance dans une intrigue sous hypnose, où le moi conscient et l’inconscient se chevauchent sans cesse, au rythme des variations tchaïkovskiennes.
Nina est ballerine au sein du prestigieux New York City Ballet. Elle consacre sa vie à la danse depuis son plus jeune âge et attend avec impatience son heure de gloire. Ainsi, lorsque Thomas Leroy, directeur artistique de la troupe, décide de faire d’elle la nouvelle danseuse étoile de sa nouvelle version du Lac des cygnes, Nina est aux anges. Mais rien n’est encore acquis, car même si elle incarne à merveille le cygne blanc, elle va devoir travailler sans relâche pour exacerber son côté sensuel, celui qui reflète le part ténébreuse du personnage : le cygne noir. Les progrès se font attendre et Leroy commence à voir en Lilly, autre danseuse prometteuse, le parfait cygne noir. Une rivalité perverse s’installe alors entre les deux danseuses. Nina n’a plus le choix, elle doit laisser son côté sombre l’envahir, quitte à prendre le risque de s’y perdre elle-même.
Thriller psychologique par excellence, l’intrigue de Black Swan nous entraîne dans un dilemme purement humain : la dualité de l’être. Une dualité qui touche tous les personnages principaux. Nina (la vedette), bien sûr, qui doit lutter contre son côté clair pour y laisser entrer assez d’obscurité. Leroy (le mentor), qui travaille à l’instinct et n’hésite pas à retourner sa veste sans complexe, à la faveur de la candidate la plus sexuellement apte. Lilly (la rivale), qui derrière ses airs de bonne volonté et de sympathie, cache un monstre d’hypocrisie et de manipulation. Beth (la déchue), qui malgré la souffrance vécue et sa haine pour Leroy n’arrive pas à vivre sans lui. Erica (la mère), qui désire tout le bonheur du monde à sa fille, mais qui ne peut pas s’empêcher de l’étouffer par peur de la perdre. Ici, tout se joue à couvert. Derrière chaque action, derrière chaque comportement, se cache une motivation égoïste et intéressée. Les personnages s’entre-dévorent en silence, sans laisser paraître le moindre indice. D’où le lien plus qu’évident avec le milieu artistique du ballet. Là où la compétition est d’une férocité sans pareille et où tout est prétexte à écraser l’autre, pour mieux grimper. Là où le corps est la meilleure arme.
Et au milieu de toutes ces dualités individuelles, nait une dualité inter-personnages. Entre Nina et Lilly. Entre le cygne blanc et le cygne noir. Tout commence avec Nina, personnage archétypal de la fille coincée, réservée et timide, tellement lisse qu’elle en devient vite énervante. Mais que pouvait-on attendre d’une fille qui se donne corps et âme à la danse, au point d’en avoir sacrifié sa jeunesse et ses relations sociales, le tout sous le couvert d’une mère tyrannique et étouffante ? Puis, petit à petit, Lilly s’insère dans l’intrigue. Femme à la beauté et aux mœurs totalement décomplexées, qui charme son entourage en feignant l’innocence, elle représente le radical opposé de Nina. Seulement voilà, il ne peut y avoir qu’une seule danseuse étoile, qui incarnera les deux cygnes. Et si Nina l’a obtenu, elle sait que ce n’est que le début d’un combat contre elle-même, mais aussi contre Lilly, sa rivale directe. C’est sur ce postulat que l’histoire et la métamorphose se déclenchent. Liant petit à petit une amitié malsaine avec Lilly, Nina se laisse malgré elle manipuler. Elle va alors découvrir et s’adonner à tout ce qu’elle (et surtout sa mère) s’était interdit jusqu’alors : sexe, envie, drogues, désir et liberté des sens. Toutes ses barrières tombent les unes après les autres. Elle est libre et presque sans défense. Elle aime ça, elle adore ça. Son cygne noir se révèle lentement, mais sûrement à elle. Nina a compris comment faire, il lui faut lâcher du lest, être ce qu’elle a toujours secrètement voulu être, accepter sa dualité, noire et blanche à la fois. Personnage torturé entre son éducation et son envie de liberté, Nina représente à elle seule l’entière métaphore du Lac des cygnes. A la limite de la paranoïa, son esprit se débat pour se libérer de ses entraves trop longtemps réajustées par sa mère, véritable figure de geôlière. On assiste donc au combat d’un être pour sa survie mentale, un combat long et éprouvant qui remet certes en question tout les principes de vie et de fonctionnement du personnage, mais qui promet au final d’être révélateur et rédempteur. C’est le prix à payer pour être soi-même, semble nous dire Aronofsky. Faire confiance à notre instinct, à notre inconscient, à notre moi non-corrompu par son environnement, qui l’a fait grandir selon ses règles, au détriment de sa vraie nature.
Basé donc sur une écriture solide, Black Swan s’envole facilement vers des sommets de technique et de mise en scène. Certes très classique, la réalisation dose à la perfection les scènes académiques et les lâcher-prise. C’est d’ailleurs ce contraste marqué qui crée tout le rythme du film. On se laisse gentiment bercer par les répétitions du spectacle, l’introduction des personnages, les dialogues et l’immersion dans le monde de la danse pour ensuite serrer notre accoudoir jusqu’à la mousse pendant trois minutes, lors d’une scène déstabilisante et éprouvante, qui nous laisse littéralement le souffle court. Et plus le film avance et plus ces scènes se rapprochent, créant une atmosphère de plus en plus oppressante, pour finir sur un final où le grandiose rivalise avec le génie. Aronofsky est un véritable artisan de l’image. On le sent. A chaque scène, voire même à chaque plan, la quasi-perfection transpire. Et une fois sorti de la salle, on se rend compte du travail phénoménal qui a dû être accompli pour arriver à une maîtrise si irréprochable du fond et de la forme. Black Swan est calibré à la minute près, au mouvement de caméra près et à la note près. Car il ne faut pas oublier la magistrale ré-interprétation de la musique du Lac des cygnes par le fidèle Clint Mansell, qui fait encore une fois preuve d’un génie discret mais tellement envoûtant. Enfin, fait de plus en plus rare dans le cinéma contemporain, on en ressort avec une impression générale, mais aussi et surtout avec des images nettes gravées dans notre esprit. Des scènes que, bien sûr, je tairai ici, par peur de gâcher le plaisir du spectateur.
En salles dès le mercredi 9 février 2011.






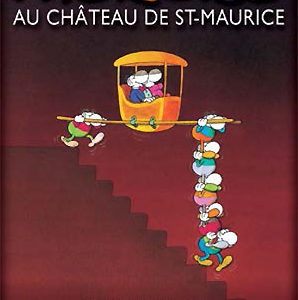

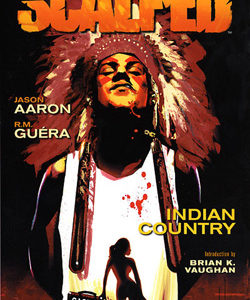
Laisser un commentaire